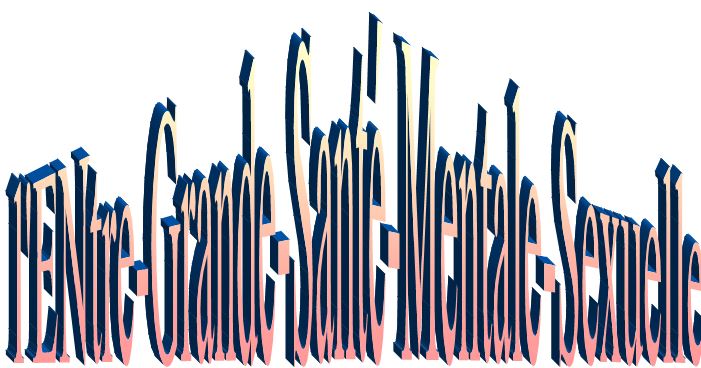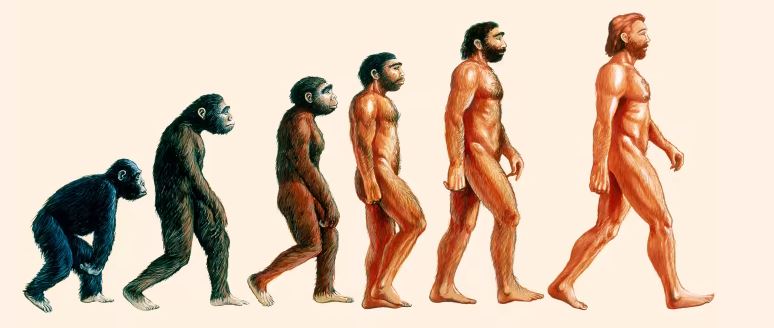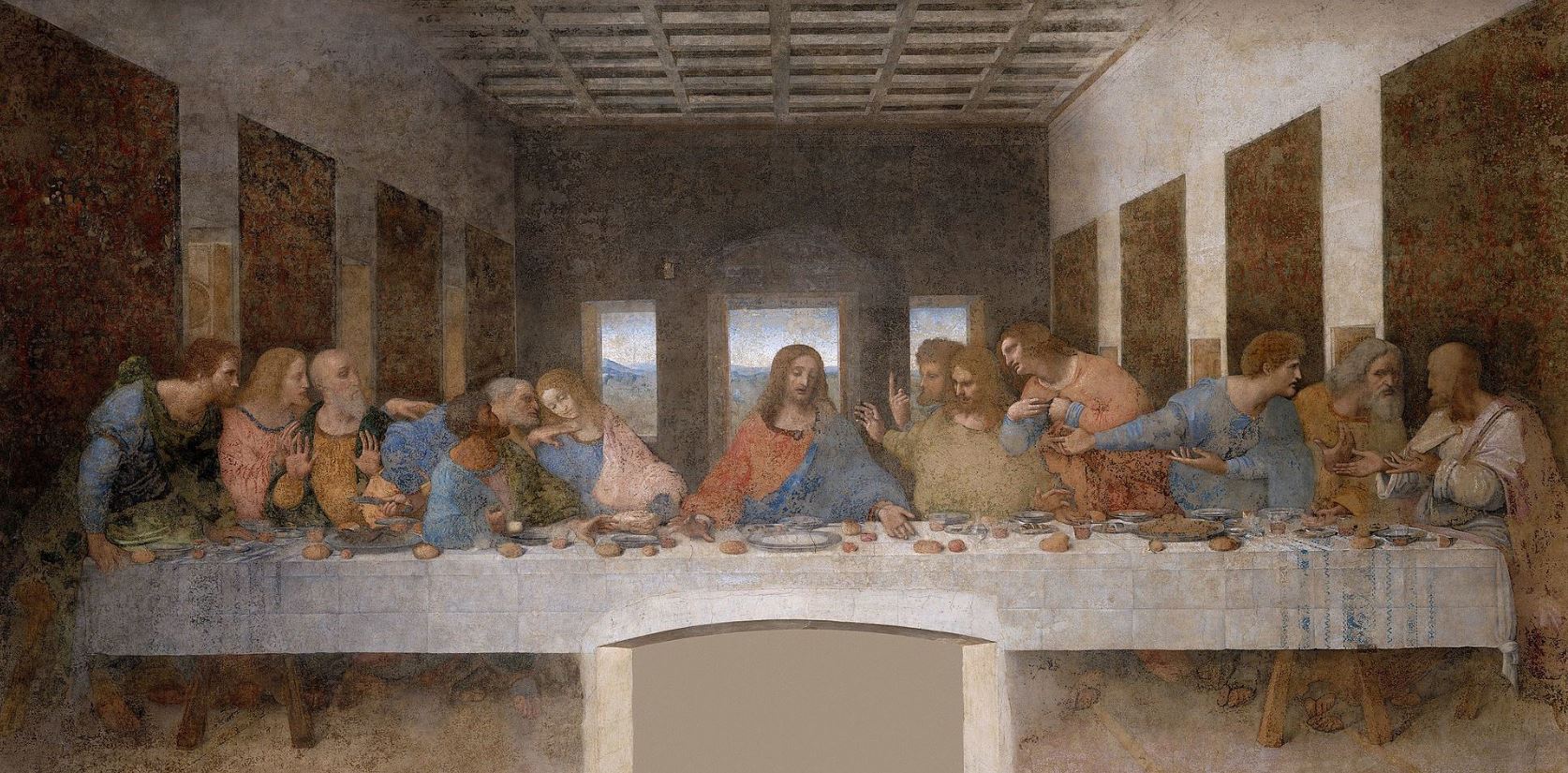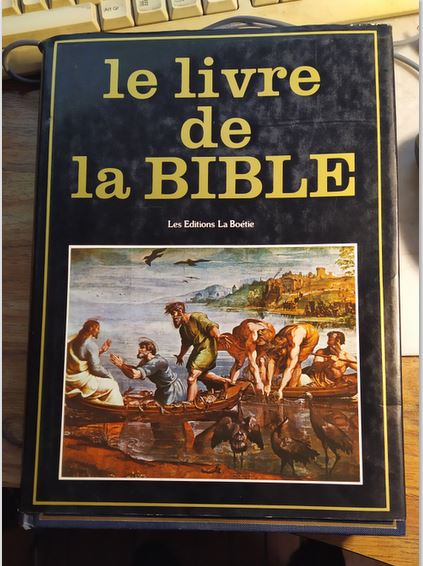C’est une norme tenace, que n’a pas fait flancher le mouvement #metoo, ni le regain du féminisme contemporain. A l’adolescence, quand se découvrent les premières amours, filles et garçons rêvent d’être en couple. Pour être un « vrai » mec ou prouver qu’on est une fille « bien », ce modèle, que décrit la sociologue Isabelle Clair dans Les Choses sérieuses. Enquête sur les amours adolescentes (Seuil, 400 pages, 21,50 euros), est au cœur des préoccupations des jeunes âgés de 15 à 20 ans en matière sentimentale et sexuelle.
Publiée en mars, cette étude est inédite par son ampleur, conduite sur vingt ans, de la banlieue populaire aux quartiers chics de la capitale, en passant par le monde rural de la Sarthe. Elle démontre à quel point ce moment des premiers émois amoureux est soumis à de nombreuses prescriptions et fortement marqué par le poids du genre.
En quoi l’expérience du couple devient-elle, au moment de l’adolescence, un « élément central de définition de soi » ?
La valorisation du couple comme norme survient très tôt, bien avant l’âge adulte des premières installations à deux. Autour de leurs 14 ans, et ce sur tous mes lieux d’enquête, les adolescents commencent à se dire « célibataire ».
Même si la plupart étaient déjà seuls avant ça, leur statut conjugal vient soudain les définir… Ou plutôt leur écart vis-à-vis de la norme sociale de la conjugalité, ce terme suggérant un manque. Le fait d’être seul devient un problème et si, à 14 ans, il n’est pas encore grave de n’avoir rien vécu sur ce point-là, plus les années passent, plus cela devient suspect. A cet âge de changements et de métamorphose, le couple confère un statut social : il rend visible le fait qu’on a su être désiré, donc qu’on a de la valeur, mais aussi permet de prouver qu’on désire bien soi-même « l’autre sexe ».
C’est avant tout le couple hétérosexuel qui est recherché ?
Ce n’est, en effet, pas un détail. A l’adolescence, le couple est hétérosexuel, et les premiers pas dans l’amour sont, à ces âges, avant tout un apprentissage de l’hétérosexualité. Même si les perceptions sociales de l’homosexualité ont bougé, y compris à l’échelle de mon enquête sur les vingt dernières années, une valorisation très forte de l’hétérosexualité demeure, avec la persistance de l’idée d’une complémentarité supposément naturelle des sexes.
Sur mes trois terrains et notamment le plus récent, au sein de la bourgeoisie parisienne progressiste, j’ai rencontré des garçons ouvertement gays. Mais si plusieurs d’entre eux étaient en couple, ce dernier se formait surtout à partir des réseaux sociaux, à l’abri des regards, quand les rencontres hétérosexuelles se faisaient au grand jour, au sein de l’espace scolaire ou dans des fêtes qui en étaient l’extension. Pour les filles, les relations homosexuelles sont moins réprouvées, à condition qu’elles restent de l’ordre de la parenthèse, de l’expérimentation. Aucune ne se disait lesbienne.
Parce que l’inscription dans la relation hétérosexuelle est une manière, dites-vous, de « faire ses preuves » en tant que fille ou en tant que garçon ?
Le moment de la fin de l’adolescence est investi comme celui où les garçons se transforment en hommes et les filles en femmes. Dès lors, les garçons doivent faire la preuve qu’ils sont à la hauteur de leur groupe de sexe, et qu’ils sont de « vrais » mecs, capables de désirer une fille, de sortir et de coucher avec elle : autrement dit, pas des « pédés ».
Derrière la mise en couple, il y a un enjeu de virilité très important. C’est pour cela que je parle du couple comme d’une forme de « parade » à ces âges. Il s’agit en partie d’une mise en scène de soi, qui permet notamment de parer au soupçon d’être homo – donc pas un « vrai homme » – pour les garçons, et pour les filles d’être des « salopes », ce stigmate collectif qui pèse encore fortement sur elles. Leur vertu dépend de leur statut conjugal, et elles prouvent par lui qu’elles sont des filles « bien » qui ne changent pas de mec « comme de chemise ». C’est alors à la fois un espace recherché par elles, dont on attend qu’elles n’expriment leurs premiers désirs sexuels que dans ce seul cadre, mais aussi de fait un lieu de contrôle de leurs comportements.
Les jeunes générations envisagent-elles pour autant toujours le couple comme leurs aînés avant eux ? Ne voit-on pas émerger une remise en question de ce modèle traditionnel au sein de la jeunesse ?
On a tendance à généraliser un phénomène et des discours en les voyant devenir numériquement plus significatifs : dans la vie ordinaire, les pratiques, elles, changent moins rapidement que les discours. Toutefois, je crois qu’il y a une réelle contestation des modèles de genre et de sexualité les plus dominants qui se fait jour dans la jeunesse, mais davantage à partir de la vingtaine. On commence à pressentir dans les enquêtes menées en ce moment une pluralisation des formes d’expériences amoureuses et sexuelles sur cette période d’âge.
Entre 15 et 20 ans, la remise en cause est plus marginale. J’ai certes eu des récits dissonants, notamment d’un trouple [relation amoureuse à trois] qui coïncidait d’ailleurs avec une contestation du binarisme de genre, mais toujours très minoritaires. Et cela ne me semble pas anodin pour la suite : si ce qui se passe à cet âge-là ne clôt évidemment pas les destinées de ces jeunes, ce sont forcément des moments fondateurs, qui imprègnent durablement leurs représentations et leurs espaces des possibles.
Au moment de l’adolescence, cette injonction au couple induit, selon vous, un changement majeur dans la manière dont chacun doit soudainement approcher « l’autre sexe »…
Alors que l’on vit dans une société où les enfants peuvent grandir et aller à l’école dans des environnements mixtes, filles et garçons se mélangent en réalité peu tout petit. Ils vivent à côté mais comme séparés : on a toujours des activités de fille, des activités de garçon, et par la suite des filières scolaires très genrées. Dans l’enfance, les études montrent une exclusion forte des filles des réseaux de sociabilité et des jeux des garçons, dont il est attendu qu’ils se distinguent de tout ce qui est associé au féminin.
Puis, quand arrive l’adolescence, il faudrait d’un coup avoir envie de passer du temps avec l’autre, avoir des choses à lui dire après avoir été encouragé à développer des activités et des goûts différents. C’est un des vrais tournants de cet âge, perturbant et parfois intimidant pour ces jeunes. Soudain, l’autre groupe doit devenir un lieu de désir et de conquête, notamment pour les garçons qui, socialement, sont censés prendre l’initiative de la séduction.
Quelle incidence cela a-t-il sur leurs relations sociales en général ?
Les études sur les réseaux de sociabilité montrent que les groupes de garçons sont particulièrement homogènes : eux, contrairement aux filles, qui reconnaissent des relations de proximité avec les garçons autres que sentimentales et sexuelles, ont tendance à peu les considérer comme de possibles amies, et à interpréter leurs relations autour du seul enjeu de la sexualité ou de la conjugalité. A leurs yeux, les filles sont souvent principalement perçues comme des objets de sexualisation, avec forcément un impact sur leurs comportements et interactions avec elles.
Au sein du couple lui-même, les dynamiques à l’œuvre tendent aussi à figer chez ces adolescents une vision des genres stéréotypée, où il est attendu de filles et de garçons qu’ils remplissent un rôle particulier…
Il y a une morale amoureuse beaucoup plus forte pour les filles que pour les garçons : elles sont supposées sentimentales, apprennent à aligner en permanence le désir sexuel, l’amour et le couple, quand leurs homologues masculins sont plutôt encouragés à savoir dissocier les trois et peuvent davantage avoir des expériences sexuelles avec des filles qu’ils n’aiment pas, hors du couple. D’ailleurs, pour eux, l’amour doit être un lien privilégié mais certainement pas le seul qui les occupe de manière visible : l’amour, c’est une affaire de filles. Encore aujourd’hui, ils sont poussés à se montrer plus détachés, moins s’impliquer. Ce qui crée beaucoup de malentendus et de déconvenues entre filles et garçons.
Dans la relation, ces attentes stéréotypées se rejouent. Parfois, l’expérience vient contredire le stéréotype : les garçons découvrent avec surprise que les filles ont aussi du désir sexuel, et les filles que des garçons aussi peuvent être très sentimentaux. Mais dès le début de la relation, et notamment dans la sexualité, un script précis perdure : les garçons doivent prendre l’initiative, être toujours « prêts », et les filles, répondre à l’initiative, sans dire oui tout de suite, mais sans trop tarder non plus.
A ces dernières revient aussi souvent, dès ces âges-là, la prise en charge du travail affectif dans le couple : nourrir le lien, organiser des sorties… Comme ce qu’ils peuvent observer dans leurs modèles familiaux.
Y a-t-il eu un effet du mouvement #metoo, qui est survenu durant vos recherches, sur l’expérience de l’amour et du sexe chez cette jeune génération ?
Ce qui a été amené dans le sillage de ce mouvement, en 2017, avait en fait commencé avant. Au cours des quarante dernières années, il y a eu des évolutions et une plus grande égalitarisation, avec une réduction de l’écart entre filles et garçons de l’âge d’entrée dans la sexualité, un rapprochement du nombre de partenaires que chacun a à cette période de la vie. Le récent #metoo et le regain du féminisme, qui s’est rallumé depuis les années 2010 justement sur les enjeux de la sexualité, auront eux aussi leurs effets, mais il est encore trop tôt pour les mesurer. D’autant que les forces de résistance sont encore vives aujourd’hui.
La norme de consentement est beaucoup plus présente, énoncée, notamment à l’école, mais elle vient buter sur des pratiques qui, elles, bougent lentement. J’ai été frappée de constater que les filles parlent de leur première entrée dans la sexualité, ou dans celle avec leur nouveau copain, en disant qu’elles étaient « prêtes », plutôt que de dire qu’elles en avaient l’envie, le désir, comme le font les garçons. Il y a encore l’idée qu’il ne faudrait pas trop les faire attendre, qu’on se force un peu – quand on n’est pas forcé tout court. Des choses intériorisées dans l’enfance, beaucoup demeurent.
.
.
.
.